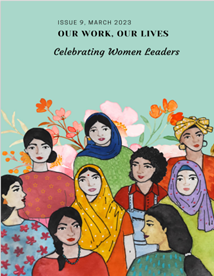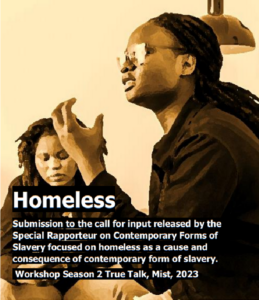Découvrez la saison 4 du podcast TRUE TALK : 7 jours pour comprendre (sept épisodes)
7 jours pour comprendre, se comprendre, faire comprendre, se faire comprendre…
Premier programme réalisé par les membres françaises de la Mist, pour toutes celles qui veulent devenir actrices de changement.
La traite des êtres humains existe en France.
En 2025, les victimes françaises sont le premier groupe de victimes identifiées par les services judiciaires depuis huit années consécutives !
Suivez les épisodes et prenez sept jours pour comprendre.
Merci à la Fondation RAJA, à la Direction générale de la cohésion sociale et à la Mairie de Paris !
Dernier avis rendu par la Mist
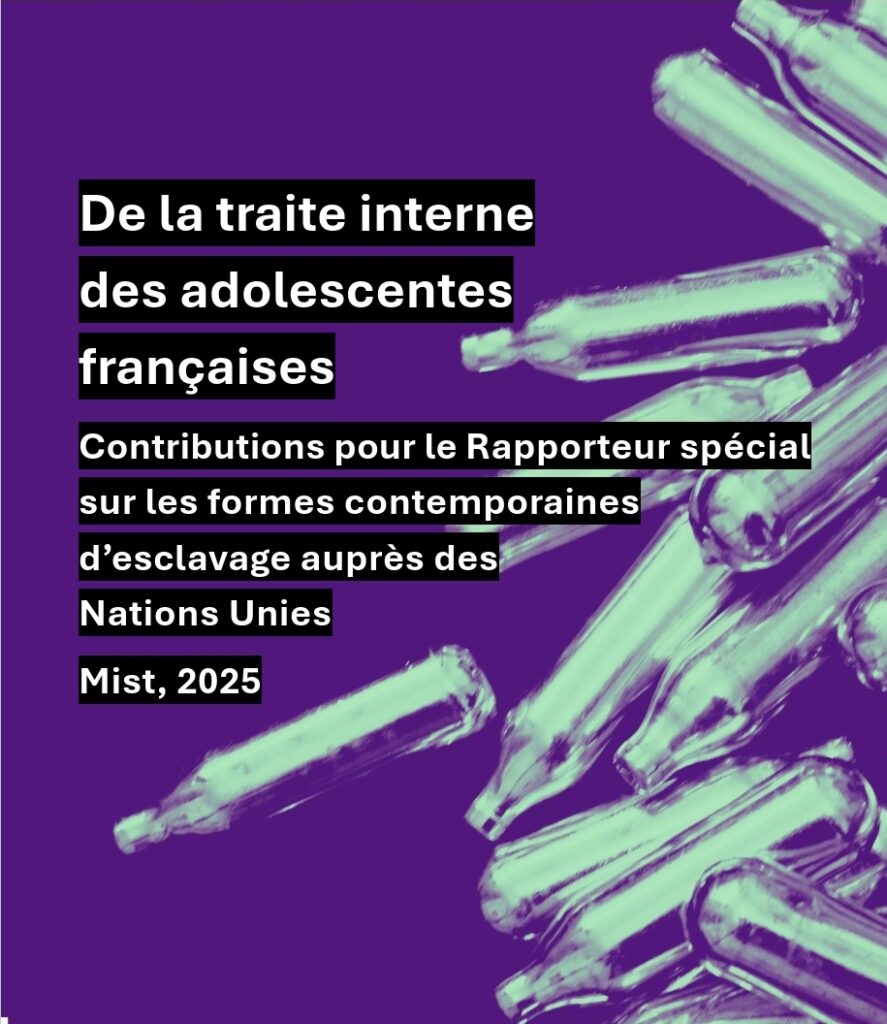
Contributions pour le Rapport sur « les pires formes de travail des enfants – faire le point du progrès et les défis restants », pour le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage auprès des Nations Unies. Élaboration du rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, à la 60e session du Conseil des droits de l’homme.
Contribution n°1 : L’exploitation sexuelle des adolescent(e)s françaises en France n’est pas appréhendée comme une forme de traite des êtres humains.
Quelles pires formes de travail des enfants sont prévalentes dans votre pays ou votre région et comment elles se manifestent ? Quels sont les facteurs essentiels et les causes profondes des pires formes de travail des enfants dans votre pays ou votre région ? Quels groupes des enfants sont plus vulnérables aux pires formes de travail des enfants dans votre pays ou votre région (e.g. autochtones, minorités, migrants, les enfants en situation d’itinérance, les enfants en situation de handicap, les enfants de diverses identités de genre non conformes, et/ou les autres) ?
En France, l’Etat considère « qu’entre 7 000 et 10 000 mineurs sont concernés par la prostitution » et que « ce phénomène, présent sur tout le territoire, touche surtout les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, avec un point d’entrée dans la prostitution de plus en plus tôt, se situant entre 14 et 15 ans pour la moitié d’entre elles[1] ». Si nous observons que ces adolescentes sont exploitées dans le cadre de faits relevant de la traite des êtres humains, cette qualification n’est jamais retenue par les tribunaux au profit du seul prisme prostituée/proxénète.
Causes profondes identifiées par notre association :
- Les proxénètes des adolescentes françaises sont généralement jugés pour proxénétisme aggravé, parfois en comparution immédiate (16% des dossiers de proxénétisme en 2023[1]), les clients ne sont quasiment jamais poursuivis. Le contexte français est marqué par un recours à la comparution immédiate qui a doublé en France depuis le début des années 2000[2]. Certains trafiquants de stupéfiants se tournent ainsi vers l’exploitation sexuelle des mineurs parce que cette activité criminelle est perçue comme plus lucrative et moins exposée aux sanctions pénales. Nous observons un sentiment global d’impunité et de banalisation chez les auteurs qui sont de plus en plus jeunes (la part de mineurs condamnés pour proxénétisme augmente de 7 points entre 2016 et 2022)[3].
- Les services français de protection de l’enfance ne sont plus opérationnels. En 2024, Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) rendait un avis en 2024[4] pour alerter sur « la crise systémique de la protection de l’enfance » : « la protection de l’enfance apparait comme un cas d’école de la non-effectivité des politiques sociales ». Nous observons que les enfants placés sous leur garde constituent désormais un groupe particulièrement vulnérable à l’exploitation sexuelle : le recrutement s’effectue souvent au sein même des foyers de l’Aide sociale à l’enfance par d’autres victimes devenues proxénètes, dans des contextes d’impuissance voir de banalisation de la part des professionnels – qui parlent par exemple de « fugues » au lieu de « disparations inquiétantes ».
- Les victimes souffrent de stigmate de la part de tous les acteurs (familles, société, professionnels) qui les considèrent souvent comme responsables voire coupables des violences qu’elles subissent. Souvent, elles préfèrent s’enfoncent dans la marginalité et l’exclusion pour échapper au jugement moral. Cela favorise leurs retours dans ces réseaux d’exploitation et le décrochage des structures d’aide. Nous observons des difficultés à se percevoir et à être perçues comme des victimes – notamment quant à la catégorisation « prostituées ».
- Beaucoup d’entre elles souffrent d’addictions, notamment au protoxyde d’azote, dont la consommation est largement utilisée par ceux qui le exploitent pour maintenir leur emprise. Ce gaz entraîne des dommages neurologiques graves, pouvant aller jusqu’à des paralysies irréversibles. Les conséquences sont telles que certaines victimes sont en situation de handicap. Or, comme le soulignait le rapport de la Cour des comptes sur la pédopsychiatrie en mars 2023[5] : « l’offre de soins psychiques est inadaptée aux besoins de la jeunesse », « l’offre est saturée », la feuille de route du Ministère de la santé mentale adoptée en 2018 « ne se fixe pas d’objectifs clairs et ne prévoit pas de calendrier de mise en œuvre », « les psychologues de l’éducation nationale sont souvent renvoyés vers des missions d’orientation scolaire » et « les professionnels libéraux méconnaissent encore trop les caractéristiques des troubles psychiques des enfants et adolescents et ne jouent donc pas suffisamment leur rôle de porte d’entrée dans le parcours de soins ».
Contribution n°2 : La participation des anciennes victimes est la seule manière efficace de surmonter le stigmate social dont souffrent les victimes.
Comment les familles et les enfants eux-mêmes collaborent pour adresser les pires formes de travail des enfants ?
Les anciennes victimes jouent un rôle central dans la mise en place et l’application des mesures de protection, notamment à travers le travail de l’association Mist[7].
La Mist est un collectif de personnes ayant été victimes de traite des êtres humains qui se mobilisent pour promouvoir l’identification d’autres victimes, leur protection puis leur inclusion, dans un parcours leur permettant de valoriser leur expérience à leur tour dans le cadre d’espaces sécures, en tant que pair-aidantes, prenant part à l’action et à la gouvernance de l’association. Plus de la moitié du conseil d’administration et de l’équipe salariée est composée de femmes qui ont été victimes d’exploitation sexuelle et qui sont accompagnées dans un parcours continu de formation, d’analyse de la pratique professionnelle et de supervision.
Les adolescentes victimes d’exploitation sont souvent peu informées, voire désinformées par des proches malveillants ou des prédateurs. Elles ont du mal à connaître et à comprendre leurs droits mais ne savent pas à qui s’adresser, sont souvent réticentes à parler à des professionnels en raison de la méfiance ou de la peur du jugement moral et de la stigmatisation. Pourtant, elles sont en grande souffrance psychologique, développent des troubles de stress post-traumatique, un état dépressif et anxieux, souvent des addictions et des pensées suicidaires.
La pair-aidance apporte une dimension humaine et empathique essentielle, en offrant un soutien direct et des conseils pratiques aux victimes et en favorisant l’identification et le signalement de cas d’exploitation sexuelle. Cette méthode de soutien mutuel permet aux victimes ayant vécu des expériences similaires de partager leurs connaissances et leur soutien avec celles qui traversent des situations comparables. Cette approche basée sur la confiance et la compréhension des réalités du terrain, s’inscrit dans un accompagnement sur le long terme favorisant l’orientation vers un hébergement sécurisant, un soutien psychologique, une assistance juridique, une insertion sociale et professionnelle. Cette approche holistique permet aux personnes de reconstruire leur vie et d’acquérir une autonomie durable.
Grace à leur expérience, les anciennes victimes participent aussi activement à la sensibilisation et la formation des professionnels (forces de l’ordre, travailleurs sociaux, magistrats, éducateurs). Cette implication permet d’améliorer la compréhension des mécanismes de la traite et de l’exploitation sexuelle, et d’adapter les politiques publiques en fonction des réalités vécues par les victimes.
Ces initiatives démontrent l’importance d’intégrer les victimes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de lutte contre la traite des mineurs.
[1] https://www.info.gouv.fr/actualite/premier-plan-national-contre-la-prostitution-des-mineurs
[2] INFOSTAT Justice 198, octobre 2024
[4] INFOSTAT Justice 198, octobre 2024
[5] https://www.lecese.fr/actualites/la-protection-de-lenfance-est-en-danger-le-cese-adopte-lavis
[6] https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-pedopsychiatrie
La Mist : une association spécialisée et innovante
La Mist est un collectif de personnes ayant été victimes de proxénétisme ou de traite aux fins d’exploitation sexuelle qui se mobilisent pour promouvoir l’identification d’autres victimes, leur protection, puis leur inclusion, dans un parcours leur permettant de valoriser leur expérience en aidant d’autres victimes à leur tour.
Cette dynamique vertueuse s’appuie sur une méthodologie d’intervention sociale unique développée auprès des personnes victimes d’exploitation sexuelle. Elle vise à favoriser la création d’espaces leur permettant de parler d’elles-mêmes au sein d’un cadre évolutif, de s’autonomiser en prenant part à l’action et à la gouvernance de l’association, de travailler en faveur de la production de recommandations, d’un meilleur accès aux droits pour les victimes et de la lutte contre la banalisation de violences ou de phénomènes d’emprise au sein des groupes de paires.
Créée en janvier 2020 par une équipe pluridisciplinaire de professionnels déjà aguerris aux problématiques de la lutte contre la traite des êtres humains, la Mist est la première association de femmes victimes de traite en France : la moitié du conseil d’administration est constituée de femmes ayant été victimes de traite alors qu’elles étaient mineures.
Dès sa première année d’existence, un groupe de membres de la Mist constituées parties civiles, a remporté la plus grosse condamnation jamais rendue en France pour des faits de traite des êtres humains, et signait un partenariat avec le Barreau de Paris pour mettre en place un mode opératoire inédit sur un territoire de prostitution parisien, entre des médiatrices-pairs nigérianes et des avocats bénévoles du Bus Paris Solidarité.
La Mist est un pôle ressources pour les victimes et les professionnels qui les rencontrent et les accompagnent.
La Mist est enregistrée sur la liste des administrateurs ad hoc auprès de la Cour d’Appel de Paris et soutient ainsi les victimes mineur.e.s devant la justice.
L’association est le premier service orienteur de France du dispositif national Ac.Sé qui permet un éloignement des victimes en insécurité vers des mises à l’abri dans d’autres régions de France (décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 relatif à l’admission au séjour, à la protection, à l’accueil et à l’hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humain).
L’association est membre de plusieurs groupes de travail nationaux dédiés à la traite er coordonnés par la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF).
La Mist est membre de la Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), de La Strada International (LSI) et du réseau Beyond Borders..
En mars 2023, les membres de la Mist ont contribué au Numéro 9 de la revue « Our Work, Our livres » de la GAATW intitulé : « Celebrating women leaders » ; ainsi qu‘à l’appel à contributions du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage : « Homeless as a cause and a consequence of contemporary forms of slavery ».